Robert Massart
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la Belgique manquait de main d’œuvre pour faire redémarrer ses industries, et l’Italie, de son côté, n’avait pas assez de travail à offrir à sa population. C’est pourquoi, le 23 juin 1946, les deux pays signèrent un accord économique relatif à l’exploitation de la houille dans le sillon Sambre et Meuse, accord appelé aussi « Des hommes contre du charbon ». Cette année, on commémore chez nous les septante-cinq ans de l’immigration italienne.
L’immigrazione
Ainsi, jusqu’au milieu des années 1950, des dizaines de milliers d’hommes venant surtout du centre et du sud de l’Italie sont arrivés en Wallonie. La population locale n’était pas toujours très gentille avec eux : on les appelait “macaronis”, “tchitchos” – l’argot “rital” n’avait pas encore franchi la frontière -, on racontait qu’ils étaient fainéants, tire-au-flanc. Jusqu’au jour où, au milieu d’un été superbe, plus personne n’a osé rire des travailleurs italiens. Ce jour-là, le 8 aout 1956, les Belges ont entendu la langue italienne résonner gravement à la radio, et tous les jours qui suivirent, dans des émissions destinées aux familles d’immigrés pour leur donner les dernières nouvelles de la catastrophe minière du Bois du Cazier, à Marcinelle.
Deux-cent-soixante-deux morts, dont cent-trente-six Italiens. Après deux semaines d’efforts désespérés, un sauveteur fit cette déclaration que nul n’a oubliée : Tutti cadaveri, ils sont tous morts. Après ce désastre, on n’a plus considéré les Italiens de Wallonie comme avant, il faut dire aussi que, sur la lancée, nous avions appris qu’ils étaient plus de cinquante-mille à être venus chez nous pour extraire le charbon au péril de leur vie, et que beaucoup vivaient dans des conditions presque infra-humaines, certains étant encore logés dans d’anciens baraquements de prisonniers de la guerre de 40-45.
Partir ou rester ?
Par la suite, une grande partie de la communauté italienne est rentrée au pays natal, les uns ayant atteint l’âge de la retraite, d’autres, après le drame de Marcinelle, préférant une vie modeste, chez eux, plutôt que de la perdre à l’étranger. D’autres encore ont quitté la Wallonie quand la crise s’y est installée, fermant les usines et les houillères et réduisant au chômage des dizaines de milliers de travailleurs.
Malgré tout, beaucoup d’Italiens sont restés chez nous, les racines étaient déjà enfouies trop profond, les enfants s’étaient habitués au pays d’accueil et s’étaient mariés, bien souvent, avec des Wallonnes et des Wallons. Ainsi, du Bassin liégeois jusqu’au Borinage, en passant par le Pays Noir et la région de La Louvière, les Italiens ont parsemé les vallées de la Sambre et de la Meuse de la lumière de leurs noms et de leur accent, ce faisant ils ont en quelque sorte relatinisé un peu cette vieille terre déjà conquise, jadis, par leurs lointains ancêtres venus à pied des bords du Tibre.
Le « frantalien » avant le franglais
Toutefois, sans devoir remonter si loin et sans attendre non plus la signature d’un « accord charbonnier », l’Italie et les Italiens ont encore influencé plusieurs fois nos pays et singulièrement notre langue. Par exemple, avons-nous conscience de parler italien si nous énonçons des phrases comme celles-ci : « Les banquiers ont alerté leurs clients les plus poltrons, mais cette alarme était une bombe de carnaval. Derrière les façades, gardés par les sentinelles et camouflés dans le clair-obscur des salons, entre le minestrone et les cassates, plus question pour les hôtes et leurs escortes de désastre ni de banqueroute. Place à la bagatelle, la guerre était passée. » ? Elles contiennent une douzaine d’italianismes.
Un italianisme est un mot propre à la langue italienne transposé dans une autre langue. Les dictionnaires recensent aujourd’hui la présence d’environ sept-cents mots d’origine italienne en français. Toutefois, nous allons voir que les emprunts à l’italien furent bien plus nombreux au seizième siècle : les lexicologues parlent alors de trois mille italianismes au moins et certains avancent le chiffre de huit mille. Que s’est-il donc passé à cette époque ?
La Renaissance
Au 14e siècle l’Italie est entrée dans une ère que l’on appellera la Renaissance : il Trecento et il Quattrocento (le 14e et le 15e siècle). Il s’agit d’une longue période d’épanouissement culturel et artistique, la sortie du Moyen Âge, due, en partie, à l’afflux de savants et d’artistes qui fuyaient la conquête de Constantinople par les Ottomans pour se réfugier en Italie, berceau de la civilisation gréco-latine qu’ils vont contribuer à redynamiser et remettre à l’honneur.
À partir du 16e siècle la France, qui sort aussi peu à peu du Moyen Âge, éprouve une forte attirance pour tout ce qui vient d’Italie. Cet engouement est favorisé d’abord par des campagnes militaires (les guerres d’Italie) de plusieurs souverains français qui prétendaient avoir des droits héréditaires sur le Milanais et le royaume de Naples. Ensuite par l’arrivée de deux reines italiennes à la cour de France : Catherine de Médicis qui épousera le fils de François 1er, le futur Henri II, et Marie de Médicis, l’épouse d’Henri IV, qui exercera la régence jusqu’à l’avènement de Louis XIII. Il faut ajouter à cela le cardinal Mazarin, ou Mazzarini, originaire des Abruzzes, qui occupera la fonction de principal ministre d’État pendant dix-neuf ans, sous Louis XIV.
Une grande italophilie
L’ensemble de ces éléments a influencé directement la société et la civilisation françaises et, bien entendu, la langue. Tous les domaines du lexique français seront touchés par les mots italiens, de la vie de cour à l’alimentation en passant par la mode vestimentaire, l’architecture, la musique, les beaux-arts et la finance. Quelques exemples : altesse, ambassade, guerre, bombe, infanterie, cantatrice, castrat, barcarolle, sonate, façade, appartement, salon, douche, balcon, espalier, dôme, coupole, dessin, aquarelle, bilan, banque, carafe, botte, caleçon, escarpin, perruque, artichaut, biscotte, cantine … Et toujours dans le domaine alimentaire, peut-on imaginer que le mot « caviar » lui-même nous soit venu de la langue italienne où caviale est une transformation du persan « havyar » qui signifie « œufs de poisson » ?
La réaction
Cette vogue italianisante devait provoquer inévitablement une réaction. Un vif sursaut d’orgueil national à une époque où le français venait d’être promu au rang de langue officielle de l’administration par l’Ordonnance de Villers-Cotterêts (1539), au détriment du latin. Cette même année paraissait le premier dictionnaire de français. Quelques décennies plus tard ce seront De la précellence du langage français, d’Henri Estienne, et La Défense et Illustration de la langue française, de Du Bellay. Plusieurs auteurs brocarderont aussi les snobs (le mot n’existait pas encore) qui « singent l’italien » avec leurs « corruptions italiques ».
Avec le temps, la mode, comme toujours, s’affaiblira et disparaitra. La plupart des italianismes ont été oubliés (on ne dit plus « spurquesse » pour saleté), de plusieurs milliers qu’ils étaient il n’en subsiste que quelques centaines qui se sont parfaitement intégrés dans leur langue d’accueil – le fait qu’il s’agissait de deux langues romanes a facilité les choses – notamment par l’assimilation morphologique : alarme a tout d’un authentique mot français, comme banqueroute ou dessin. On n’y reconnait plus leur « passé » italien : all’arme (aux armes), la banca è rotta (le banc est cassé, rompu), il disegno, disegnare (le dessin, dessiner).
Italianismes et anglicismes : même combat ?
On ne peut pas en dire autant de l’afflux d’anglicismes que le français subit depuis le vingtième siècle, car la situation est différente : au 16e siècle les communications étaient lentes et les échanges linguistiques se faisaient surtout oralement. Les mots étrangers étaient prononcés selon les habitudes phonétiques de leur langue d’accueil. Aujourd’hui, la plupart des mots anglais nous arrivent par la voie écrite et très rapidement. Ils n’ont ni le temps ni la possibilité de se fondre dans la langue française, ce qui n’était pas encore le cas il y a un siècle quand packet boat devenait un paquebot et riding coat une redingote.
Et maintenant ?
Et, me direz-vous, il n’y a plus eu d’emprunts à l’italien depuis la Renaissance ? Si, bien sûr, mais moins nombreux et réservés à quelques domaines spécifiques : la musique, la cuisine : opéra, diva, bel canto, spaghetti, carpaccio, lasagne, pizza, spumante, etc. Aussi quelques occurrences liées à l’Église catholique, par exemple la papamobile.
L’autostrade ou l’autoroute ?
Pour terminer, le mot « autostrade » est un cas intéressant qui mérite quelques commentaires. Il est apparu pendant la première moitié du siècle passé, l’Italie ayant en quelque sorte « inventé » les autoroutes. La première, dans la région de Milan, date de 1924. Mussolini avait l’ambition de renouer avec la tradition romaine des fameuses chaussées qui sillonnaient autrefois tout l’Empire. Le mot « autostrada » en italien est une sorte de mot valise formé sur « strada », la route ou la rue, et « automobili » : route réservée aux automobiles. Bientôt le concept et le mot ont été imités en Allemagne (Autobahn). En français « autoroute » apparait à la même époque, mais il ne s’est répandu que dans les années 1950 avec les premières constructions autoroutières françaises.
Les pays francophones ont adopté l’autoroute. Toutefois, en Belgique, il y eut un peu de flottement dans l’usage. Le mot italien, francisé, « autostrade » a concurrencé « autoroute » pendant quelques années. Peut-être parce que les Belges le confondaient au début avec un mot néerlandais, « strade » étant proche de « straat ». Autoroute se dit en néerlandais « autosnelweg ».















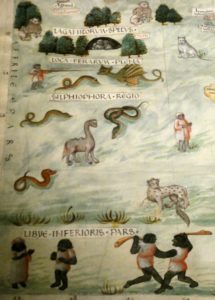

 Le Trésor d’Oignies, classé parmi les « sept merveilles de Belgique », a longtemps été hébergé dans un endroit totalement confidentiel, dans une salle du couvent des Sœurs de Notre-Dame, à Namur. Le lieu, pas très adapté, mais avec le charme intimiste des recoins un peu secrets, avait été surnommée par dérision « le plus petit musée du pays ». Cédé à la Fondation Roi Baudoin en 2010, cet ensemble d’orfèvrerie du XIIIe siècle, comprenant une quarantaine de pièces en lien avec le même artiste, est maintenant exposé dans des conditions optimales, au Musée des Arts anciens du Namurois.
Le Trésor d’Oignies, classé parmi les « sept merveilles de Belgique », a longtemps été hébergé dans un endroit totalement confidentiel, dans une salle du couvent des Sœurs de Notre-Dame, à Namur. Le lieu, pas très adapté, mais avec le charme intimiste des recoins un peu secrets, avait été surnommée par dérision « le plus petit musée du pays ». Cédé à la Fondation Roi Baudoin en 2010, cet ensemble d’orfèvrerie du XIIIe siècle, comprenant une quarantaine de pièces en lien avec le même artiste, est maintenant exposé dans des conditions optimales, au Musée des Arts anciens du Namurois. C’est ici qu’intervient le deuxième personnage de ce trio : un certain Jacques, né à Vitry, étudiant en théologie à Paris : la crosse de Jacques de Vitry). Attiré par la réputation de la sainte et par le récit de ses miracles, il délaisse les controverses savantes de la capitale française pour s’installer à Oignies et vivre la religion de manière plus intense, moins froidement intellectuelle que dans les écoles. Il reste attaché au lieu aussi longtemps que vit la sainte, qui le convainc toutefois de terminer son cursus et d’être ordonné prêtre pendant cette période. Après le décès de son inspiratrice, il rédige une biographie de Marie.
C’est ici qu’intervient le deuxième personnage de ce trio : un certain Jacques, né à Vitry, étudiant en théologie à Paris : la crosse de Jacques de Vitry). Attiré par la réputation de la sainte et par le récit de ses miracles, il délaisse les controverses savantes de la capitale française pour s’installer à Oignies et vivre la religion de manière plus intense, moins froidement intellectuelle que dans les écoles. Il reste attaché au lieu aussi longtemps que vit la sainte, qui le convainc toutefois de terminer son cursus et d’être ordonné prêtre pendant cette période. Après le décès de son inspiratrice, il rédige une biographie de Marie. A partir de 1222 et jusqu’après la mort de Jacques de Vitry en 1240, une question se pose au prieuré d’Oignies, qui est un petit patelin en pleine campagne, pas loin de Namur : comment gérer cet afflux de richesses, d’argent, d’or, de reliques, de pierreries et de curiosités exotiques, émaux et verres byzantins, égyptiens ou syriens ? A qui confier la fabrication des châsses, reliquaires et objets liturgiques souhaités par Jacques de Vitry ? C’est là qu’intervient le troisième personnage, lui aussi sorti à peu près de nulle part : frère Hugo.
A partir de 1222 et jusqu’après la mort de Jacques de Vitry en 1240, une question se pose au prieuré d’Oignies, qui est un petit patelin en pleine campagne, pas loin de Namur : comment gérer cet afflux de richesses, d’argent, d’or, de reliques, de pierreries et de curiosités exotiques, émaux et verres byzantins, égyptiens ou syriens ? A qui confier la fabrication des châsses, reliquaires et objets liturgiques souhaités par Jacques de Vitry ? C’est là qu’intervient le troisième personnage, lui aussi sorti à peu près de nulle part : frère Hugo. Il n’a pas un tempérament mystique comme Marie, il n’imaginerait sans doute pas faire des miracles par des débordements de piété, mais ce n’est pas non plus un homme d’action, un caractère tempétueux et flamboyant, comme Jacques de Vitry, qui se serait morfondu de se retrouver ainsi enfermé dans une étroite carrière ecclésiastique dans un petit établissement rural. Hugo honore le ciel à sa façon, par l’esthétique, en ornant des manuscrits de la Bible et du matériel liturgique. Une voie qu’avait prônée, un peu plus tôt, en France, Suger, abbé de Saint-Denis, constructeur de la toute première cathédrale gothique, qui devait se défendre d’accusations de distraire le fidèle en frivolités et de dilapider les moyens et les énergies en dépenses de luxe.
Il n’a pas un tempérament mystique comme Marie, il n’imaginerait sans doute pas faire des miracles par des débordements de piété, mais ce n’est pas non plus un homme d’action, un caractère tempétueux et flamboyant, comme Jacques de Vitry, qui se serait morfondu de se retrouver ainsi enfermé dans une étroite carrière ecclésiastique dans un petit établissement rural. Hugo honore le ciel à sa façon, par l’esthétique, en ornant des manuscrits de la Bible et du matériel liturgique. Une voie qu’avait prônée, un peu plus tôt, en France, Suger, abbé de Saint-Denis, constructeur de la toute première cathédrale gothique, qui devait se défendre d’accusations de distraire le fidèle en frivolités et de dilapider les moyens et les énergies en dépenses de luxe. Le frère Hugo est conscient de la très grande beauté de ses réalisations, il signe fièrement ses plus belles pièces ou même s’y représente les offrant au Seigneur. Mais il n’est pas snob ni à l’affût de la mode. Il ne se veut ni l’ambassadeur ni le promoteur des dernières nouveautés de l’iconographie et de la technique, comme a pu l’être Suger, toujours à la pointe de l’avant-garde. Son écolage à lui est un peu daté, provincial, archaïsant, encore proche du roman, et son art sera la dernière grande réalisation, dans la région, de l’orfèvrerie venue du temps lointains des tribus germaniques, qui privilégiaient le remplissage, les cabochons brillants, les marqueteries de pierres ou d’émaux de couleur, les monstres bizarres, les entrelacs et les rinceaux.
Le frère Hugo est conscient de la très grande beauté de ses réalisations, il signe fièrement ses plus belles pièces ou même s’y représente les offrant au Seigneur. Mais il n’est pas snob ni à l’affût de la mode. Il ne se veut ni l’ambassadeur ni le promoteur des dernières nouveautés de l’iconographie et de la technique, comme a pu l’être Suger, toujours à la pointe de l’avant-garde. Son écolage à lui est un peu daté, provincial, archaïsant, encore proche du roman, et son art sera la dernière grande réalisation, dans la région, de l’orfèvrerie venue du temps lointains des tribus germaniques, qui privilégiaient le remplissage, les cabochons brillants, les marqueteries de pierres ou d’émaux de couleur, les monstres bizarres, les entrelacs et les rinceaux.

 Ce soin presque maniaque dans les détails et cet équilibre parfait entre la composition générale et les ornements ont engendré une des manifestations les plus raffinées de l’orfèvrerie « barbare » qui était venue de la steppe avec les grandes invasions. Mais c’est aussi son chant du cygne : quand l’atelier d’Oignies s’éteindra avec la disparition des finances de Jacques de Vitry et avec celle d’Hugo, la tradition de l’ornementation pure s’évanouira peu à peu en Occident. Le gothique, même flamboyant, soumettra ses extravagantes volutes à l’architecture, et les figurations humaines ou animales, de plus en plus en plus indépendantes, y demanderont vite des représentations de l’espace moins compactes, moins encombrées, moins saturées de la lumière dorée du Royaume des Cieux, un espace où l’air du monde civil peut circuler.
Ce soin presque maniaque dans les détails et cet équilibre parfait entre la composition générale et les ornements ont engendré une des manifestations les plus raffinées de l’orfèvrerie « barbare » qui était venue de la steppe avec les grandes invasions. Mais c’est aussi son chant du cygne : quand l’atelier d’Oignies s’éteindra avec la disparition des finances de Jacques de Vitry et avec celle d’Hugo, la tradition de l’ornementation pure s’évanouira peu à peu en Occident. Le gothique, même flamboyant, soumettra ses extravagantes volutes à l’architecture, et les figurations humaines ou animales, de plus en plus en plus indépendantes, y demanderont vite des représentations de l’espace moins compactes, moins encombrées, moins saturées de la lumière dorée du Royaume des Cieux, un espace où l’air du monde civil peut circuler.
 Le premier, appelé familièrement la « Maison de Roi », n’est plus à présenter. Sa pittoresque silhouette néo-gothique, face à l’hôtel de ville, est connue de tous ceux qui ont mis le pied à la Grand-Place (ill. 1). Mais si tous les Bruxellois et beaucoup de Belges en connaissent la façade, peu en poussent la porte : on visite plutôt des musées en voyage ou en excursion, quand on a des loisirs, mais rarement près de chez soi, où d’autres urgences et propositions nous accaparent. L’édifice abrite pourtant un établissement public attachant, le « Musée de la Ville de Bruxelles ».
Le premier, appelé familièrement la « Maison de Roi », n’est plus à présenter. Sa pittoresque silhouette néo-gothique, face à l’hôtel de ville, est connue de tous ceux qui ont mis le pied à la Grand-Place (ill. 1). Mais si tous les Bruxellois et beaucoup de Belges en connaissent la façade, peu en poussent la porte : on visite plutôt des musées en voyage ou en excursion, quand on a des loisirs, mais rarement près de chez soi, où d’autres urgences et propositions nous accaparent. L’édifice abrite pourtant un établissement public attachant, le « Musée de la Ville de Bruxelles ». C’est dans la Maison du Roi qu’on peut ainsi voir l’authentique Saint-Michel du sommet de l’hôtel de ville, remplacé lors de la restauration récente, ou certains ornements baroques qui ont dû être reconstitués sur les façades des maisons des corporations, ou alors, plus étranges, quelques unes des figures grotesques qui soutiennent la corniche du chœur roman de Notre-Dame de la Chapelle, la plus ancienne église de Bruxelles (ill. 2).
C’est dans la Maison du Roi qu’on peut ainsi voir l’authentique Saint-Michel du sommet de l’hôtel de ville, remplacé lors de la restauration récente, ou certains ornements baroques qui ont dû être reconstitués sur les façades des maisons des corporations, ou alors, plus étranges, quelques unes des figures grotesques qui soutiennent la corniche du chœur roman de Notre-Dame de la Chapelle, la plus ancienne église de Bruxelles (ill. 2). Si on voit sur la façade de ce prestigieux bâtiment officiel tant de moines qui boivent et qui ripaillent (ill. 3), c’est parce qu’il y avait là un bistrot portant un nom du genre « la cave des moines ». De même pour le chapiteau avec des Noirs en turban : il surplombait l’emplacement de la « taverne du maure ». Le curieux chapiteau où des gens manipulent des chaises avec des pelles (ill. 4) serait, lui, issu d’un jeu de mots en flamand sur le supplice de l’estrapade, qui se pratiquait, semble-t-il, à peu près en face de cet endroit.
Si on voit sur la façade de ce prestigieux bâtiment officiel tant de moines qui boivent et qui ripaillent (ill. 3), c’est parce qu’il y avait là un bistrot portant un nom du genre « la cave des moines ». De même pour le chapiteau avec des Noirs en turban : il surplombait l’emplacement de la « taverne du maure ». Le curieux chapiteau où des gens manipulent des chaises avec des pelles (ill. 4) serait, lui, issu d’un jeu de mots en flamand sur le supplice de l’estrapade, qui se pratiquait, semble-t-il, à peu près en face de cet endroit.  On voit que l’art de Brueghel, avec ses proverbes, sa verve populaire et ses jeux de mots soigneusement illustrés, a des racines très profondes.
On voit que l’art de Brueghel, avec ses proverbes, sa verve populaire et ses jeux de mots soigneusement illustrés, a des racines très profondes.





















 Sans détailler les rôles de chacun(e), nous voulons dire combien nous avons aimé retrouver Muriel Legrand, Catherine Salée (mère et belle-mère de la mariée), Philippe Vauchel (joggeur) et découvrir Frank Michaux (l’Ange de la mort), Pierre Aucaigne (le professeur, le moine tibétain), Robert Bouvier (Bobitshek), Lee Maddeford (joggeur, musicien), sans oublier Frank Arnaudon (père de la mariée), Thierry Romanens (père du marié, mère de Bobitshek), Jeanne Dailler (la mariée), Fabian Dorsimont (le marié), Laurence Maître (jeune invitée aux noces). Elles et eux incarnent les personnages, chantent, jouent de l’accordéon, de la guitare, du piano ou du cor à piston. Un spectacle complet ! Du gra
Sans détailler les rôles de chacun(e), nous voulons dire combien nous avons aimé retrouver Muriel Legrand, Catherine Salée (mère et belle-mère de la mariée), Philippe Vauchel (joggeur) et découvrir Frank Michaux (l’Ange de la mort), Pierre Aucaigne (le professeur, le moine tibétain), Robert Bouvier (Bobitshek), Lee Maddeford (joggeur, musicien), sans oublier Frank Arnaudon (père de la mariée), Thierry Romanens (père du marié, mère de Bobitshek), Jeanne Dailler (la mariée), Fabian Dorsimont (le marié), Laurence Maître (jeune invitée aux noces). Elles et eux incarnent les personnages, chantent, jouent de l’accordéon, de la guitare, du piano ou du cor à piston. Un spectacle complet ! Du gra nd théâtre, vraiment ! Et une scénographie – due à Didier Payen – qui n’impose rien mais permet, dans sa simplicité et sa mobilité, de s’adapter aux lieux extrêmement variés où se situe l’action. La salle – comble – n’a pas ménagé les applaudissements à ces Funérailles d’hiver dont les représentations se sont données au Jacques Franck (94, chaussée de Waterloo, 1060 Bruxelles) du 8 au 23 janvier 2019. Nous espérons vivement que le Rideau reprendra le spectacle lors d’une prochaine saison
nd théâtre, vraiment ! Et une scénographie – due à Didier Payen – qui n’impose rien mais permet, dans sa simplicité et sa mobilité, de s’adapter aux lieux extrêmement variés où se situe l’action. La salle – comble – n’a pas ménagé les applaudissements à ces Funérailles d’hiver dont les représentations se sont données au Jacques Franck (94, chaussée de Waterloo, 1060 Bruxelles) du 8 au 23 janvier 2019. Nous espérons vivement que le Rideau reprendra le spectacle lors d’une prochaine saison 


 L’AJPBE et le monde de la presse périodique ont perdu, ce 20 mars 2018, l’administrateur-secrétaire et confrère Christian Vanderwinnen.
L’AJPBE et le monde de la presse périodique ont perdu, ce 20 mars 2018, l’administrateur-secrétaire et confrère Christian Vanderwinnen.
