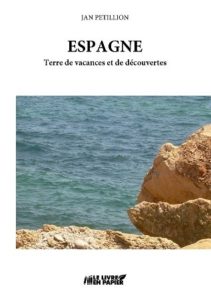Pour tous ces jeunes gens cela devait être la « der des der », c’était sans compter sur une bande d’idiots n’ayant pas digéré la victoire des Alliés et le Traité de Versailles. La seconde guerre mondiale couvait déjà…

En parlant de « pensée pour les combattants de 1914 – 1918 », un nom me revient en mémoire, celui de l’Adjudant Bourgeois du 19ème Bataillon de Chasseurs à Pied. Cette unité française est venue, à cette époque, combattre dans notre beau Royaume.
J’ai passé beaucoup de temps avec cet Adjudant, voici pourquoi…
Le carnet de marche du 19ème BCP nous apprend qu’il est arrivé en Belgique par Adinkerke le 22 octobre 1914 :
« – Ypres est abordée en pleine nuit. Les habitants ont fui sous le premier bombardement, la ville est complètement déserte, le quartier de la gare brûle, des lueurs d’incendies inondent le ciel jusqu’aux abords de la cathédrale, au-dessus de nos têtes sifflent, en passant, les obus ».
Ainsi vue, avec ses halles sinistrement éclairées, la célèbre place d’Ypres revêt, dans cette nuit d’horreur, un aspect d’une grandeur tragique et impressionnante, que n’ont jamais pu oublier ceux qui en furent les témoins. Au grand jour seulement le 19ème BCP atteint Kruisstraathoek. Il y prend quelques heures de repos, puis, à midi, se remet en route, par Dickebusch, pour Mille-Kruis, il y passera la nuit du 9 au 10 novembre 1914 ».
Quelques pages plus loin, nous lisons ceci :
«L’offensive ennemie du 10 novembre avait rejeté tous nos éléments de la rive droite, nous recevons mission de nous y rétablir, et, quand nous quitterons Steenstraat, le 29, la tête de pont face à Bixschoot sera reconstituée, avec quatre compagnies sur la rive droite».
A cette époque toute la 42ème D.I. se porte vers Ypres, le 19ème BCP marchant par Elverdinghe, Poperinghe, puis Vlamertinghe. Zillebeke – Dans les premiers jours de décembre, elle est en avant de Zillebeke, entre la route de Menin et celle d’Armentières. Vie de secteur active, pénible, sans repos, avec des tranchées encore rudimentaires, profondes en première ligne, mais sans boyaux, sans abris, et de l’eau partout. Le bataillon est d’abord dans les bois à l’est de Zillebeke (Butte aux Anglais), les opérations s’y multiplient, visant principalement le fortin de la côte 60. Au cours de l’une d’elles, le 17 décembre, l’héroïque adjudant Bourgeois, de la 1ère compagnie, illustre glorieusement la belle devise du bataillon : il emmène sa section à l’assaut au cri de « En avant toujours ». Il tombera aussitôt, mortellement frappé, et il achèvera le « Repos ailleurs ».
A cette époque, les français avaient ouvert un hôpital militaire dans la ferme Quaghebeur, du nom du fermier, à quelques kilomètres de là, à Poperinghe. Connut aujourd’hui sous le nom de Lijssenthoek Military Cemetery. En effet après la France, cet hôpital fût agrandi par les Anglais. Il y a eu plus de 4000 lits. Un cimetière militaire fût ouvert devant la ferme où furent enterrés 10.784 militaires de 30 nationalités.
C’est à cet endroit que l’Adjudant Bourgeois a été évacué et y est mort quelques jours plus tard. Ensuite…. Son corps a disparu. Impossible de le retrouver.






 Sans détailler les rôles de chacun(e), nous voulons dire combien nous avons aimé retrouver Muriel Legrand, Catherine Salée (mère et belle-mère de la mariée), Philippe Vauchel (joggeur) et découvrir Frank Michaux (l’Ange de la mort), Pierre Aucaigne (le professeur, le moine tibétain), Robert Bouvier (Bobitshek), Lee Maddeford (joggeur, musicien), sans oublier Frank Arnaudon (père de la mariée), Thierry Romanens (père du marié, mère de Bobitshek), Jeanne Dailler (la mariée), Fabian Dorsimont (le marié), Laurence Maître (jeune invitée aux noces). Elles et eux incarnent les personnages, chantent, jouent de l’accordéon, de la guitare, du piano ou du cor à piston. Un spectacle complet ! Du gra
Sans détailler les rôles de chacun(e), nous voulons dire combien nous avons aimé retrouver Muriel Legrand, Catherine Salée (mère et belle-mère de la mariée), Philippe Vauchel (joggeur) et découvrir Frank Michaux (l’Ange de la mort), Pierre Aucaigne (le professeur, le moine tibétain), Robert Bouvier (Bobitshek), Lee Maddeford (joggeur, musicien), sans oublier Frank Arnaudon (père de la mariée), Thierry Romanens (père du marié, mère de Bobitshek), Jeanne Dailler (la mariée), Fabian Dorsimont (le marié), Laurence Maître (jeune invitée aux noces). Elles et eux incarnent les personnages, chantent, jouent de l’accordéon, de la guitare, du piano ou du cor à piston. Un spectacle complet ! Du gra nd théâtre, vraiment ! Et une scénographie – due à Didier Payen – qui n’impose rien mais permet, dans sa simplicité et sa mobilité, de s’adapter aux lieux extrêmement variés où se situe l’action. La salle – comble – n’a pas ménagé les applaudissements à ces Funérailles d’hiver dont les représentations se sont données au Jacques Franck (94, chaussée de Waterloo, 1060 Bruxelles) du 8 au 23 janvier 2019. Nous espérons vivement que le Rideau reprendra le spectacle lors d’une prochaine saison
nd théâtre, vraiment ! Et une scénographie – due à Didier Payen – qui n’impose rien mais permet, dans sa simplicité et sa mobilité, de s’adapter aux lieux extrêmement variés où se situe l’action. La salle – comble – n’a pas ménagé les applaudissements à ces Funérailles d’hiver dont les représentations se sont données au Jacques Franck (94, chaussée de Waterloo, 1060 Bruxelles) du 8 au 23 janvier 2019. Nous espérons vivement que le Rideau reprendra le spectacle lors d’une prochaine saison 


 L’AJPBE et le monde de la presse périodique ont perdu, ce 20 mars 2018, l’administrateur-secrétaire et confrère Christian Vanderwinnen.
L’AJPBE et le monde de la presse périodique ont perdu, ce 20 mars 2018, l’administrateur-secrétaire et confrère Christian Vanderwinnen.